Myopathie des ceintures de type R1 (calpaïnopathie)
La myopathie des ceintures avec déficit en calpaïne (LGMD R1 liée à la calpaïne), appelée aussi dystrophie musculaire des ceintures de type R1 ou calpaïnopathie, est une maladie rare qui touche le muscle. Elle se manifeste par une diminution progressive de la force des muscles du bassin et des cuisses (ceinture pelvienne) et des épaules (ceinture scapulaire).
La myopathie des ceintures de type R1 : qu'est-ce que c'est ?
La myopathie des ceintures avec déficit en calpaïne 3 (dystrophie musculaire des ceintures de type R1, LGMD R1 liée à la calpaïne ou calpaïnopathie) est une maladie génétique rare du muscle. Le tissu musculaire se transforme petit à petit, et perd de son intégrité structurelle : il devient « dystrophique » (d’où le nom de dystrophie musculaire des ceintures). Progressivement, certains muscles perdent du volume, s'affaiblissent, leur capacité de régénération diminue...
La LGMD R1 se manifeste initialement par une baisse progressive de la force des muscles des cuisses et du bassin (ceinture pelvienne), ceux des épaules (ceinture scapulaire) et du tronc (dos, poitrine et ventre). Les premiers signes de la maladie apparaissent dans l’enfance ou l’adolescence, en général avant 20 ans : démarche dandinante, difficultés pour se relever du sol, à monter des escaliers…
La maladie appartient au groupe des myopathies des ceintures («Limb Girdle Muscular Dystrophy» en anglais ou LGMD), dont elle représente la forme la plus fréquente (environ 30 % en moyenne de tous les cas de LGMD rapportés). En France, au total, entre 600 et 2500 personnes environ seraient atteintes par une LGMD R1. Plusieurs populations où la fréquence de la calpaïnopathie est particulièrement élevée ont été décrites à travers le monde, notamment chez les Petits Blancs (Île de la Réunion), les Basques ou les Amish (États-Unis).
À quoi est-elle due ?
La maladie est due à des anomalies du gène CAPN3, codant la calpaïne 3 (d'où le nom de calpaïnopathie), une protéine indispensable au bon fonctionnement des muscles. C’est une maladie héréditaire qui se transmet principalement de manière autosomique récessive, et plus rarement sur le mode autosomique dominant. Dans certains cas, la LGMD R1 peut être due à des mutations dites « de novo », qui n’étaient présentes chez aucun des deux parents.
Que peut-on faire ?
La prise en charge vise principalement à améliorer le confort de vie des malades et à prévenir les complications, en particulier au niveau des muscles et des articulations.
- Le diagnostic et la prise en charge d'une LGMD R1 se conçoivent au mieux dans le cadre de consultations pluridisciplinaires spécialisées dans les maladies neuromusculaires.
- Une surveillance annuelle est recommandée pour faire un bilan musculaire, orthopédique, cardiaque et respiratoire.
- La prise en charge orthopédique (kinésithérapie, appareillage) doit être précoce, régulière et adaptée à chaque situation individuelle. Elle permet de lutter notamment contre l’enraidissement musculaire et les rétractions, et d’entretenir la souplesse des articulations.
- Pour faciliter la marche et soulager certaines douleurs, la chirurgie (ténotomie) peut être envisagée pour corriger les rétractions des tendons d'Achille.
- Des aides techniques (canne, support de bras, pince à long manche...) peuvent permettre de réaliser certains gestes de la vie quotidienne que la gêne musculaire rend difficiles ou impossibles. L’utilisation d’un fauteuil roulant permet de conserver son autonomie de déplacement.
- Une assistance respiratoire est très exceptionnellement nécessaire.
- Un suivi cardiologique régulier permet de mettre en place un traitement adapté au cas où des signes cardiaques éventuels seraient détectés par les examens médicaux.
- Le conseil génétique permet d'informer et d'accompagner une personne, ou une famille, sur le risque de développer ou de transmettre cette maladie.
Comment fait-on le diagnostic ?
Le diagnostic est basé sur l’identification des muscles atteints, l’âge d’apparition des premiers symptômes et le mode de transmission génétique de la maladie. Il s’appuie sur des examens médicaux (prise de sang, scanner ou IRM musculaire, électromyogramme, biopsie musculaire) pour préciser l’étendue de l’atteinte musculaire et ses spécificités et identifier la mutation génétique en cause.
- Le bilan biologique sanguin montre généralement une élévation de l’enzyme musculaire créatine phospho-kinase (ou CPK), et l’électromyogramme révèle une absence de lésions nerveuses et une origine musculaire (myopathique) de la maladie.
- L’analyse par microscopie des échantillons musculaires prélevés par biopsie montre des particularités de la structure cellulaire caractéristiques d’une « dystrophie » du muscle. Notamment avec des zones contenant des fibres de différentes tailles, indicatrices d’un phénomène de dégénérescence-régénération répété.
- L’analyse génétique mettant en évidence une mutation pathologique dans le gène CAPN3 est indispensable pour poser avec certitude le diagnostic de calpainopathie.
Des études cliniques pour trouver des traitements efficaces
Différentes stratégies thérapeutiques sont à l’étude dans les myopathies des ceintures ; elles ciblent et agissent à différents niveaux (ADN, protéine, métabolisme…) de la chaine d’évènements menant à la maladie.
- La thérapie génique consiste à insérer dans les cellules de la personne malade un « gène-médicament » qui compensera le gène muté originel et assurera sa fonction. Les essais cliniques de thérapie génique dans les myopathies des ceintures se multiplient, et des résultats préliminaires encourageants (LGMD R4, R9…) ont déjà été obtenus dans plusieurs d’entre eux.
Pour en savoir plus :
la thérapie génique dans les myopathies des ceintures (site du Groupe d’intérêt LGMD de l’AFM-Téléthon).
- La thérapie cellulaire vise à administrer à la personne malade des cellules souches d’un donneur sain (allogreffe) ou du soi (autogreffe) après les avoir corrigées par édition génique (notamment grâce à l’outil CRISPR/Cas9), pour restaurer les capacités réparatrices du muscle.
- La thérapie pharmacologique utilise des petites molécules de natures différentes (sucres, protéines, acides aminés…) pour corriger des processus biologiques (glycosylation, autophagie…) perturbés chez le malade. Plusieurs candidats-médicaments sont à l’essai dans les LGMD, comme le ribitol ou le bazédoxifène.
Depuis 2015, le laboratoire I-stem travaille sur des cellules modèles de myopathies des ceintures pour identifier des candidats-médicaments parmi des molécules déjà connues.
Améliorer les connaissances sur les myopathies des ceintures
- Depuis la découverte du gène de la calpaïne 3 en 1995 par l'équipe d'Isabelle Richard à Généthon, une trentaine de gènes différents ont été identifiés dans les myopathies des ceintures. Certains de ces gènes sont aussi impliqués dans d'autres formes de maladies neuromusculaires, notamment dans les dystrophies musculaires congénitales, les myopathies distales ou myofibrillaires.
- Depuis 2018, face à la complexité génétique grandissante, une nouvelle nomenclature du groupe a été établie par des experts de l’ENMC. Les nouvelles dénominations et les classements proposés sont ceux aujourd’hui majoritairement utilisés par la communauté scientifique et médicale.
- Plusieurs études observationnelles et bases de données sont en cours pour mieux l’histoire naturelle des différentes formes de myopathies des ceintures. Ces données servent notamment à la préparation des futurs essais cliniques en identifiant les meilleurs critères d’évaluation clinique pour mesurer au mieux les effets de candidats-médicaments.
Le groupe d’intérêt AFM-Téléthon LGMD
Il rassemble des malades atteints de LGMD, experts de cette maladie. En plus du partage d’expériences, il apporte une information médicale et scientifique régulière sur son blog ou lors de journées d’information, en lien avec des médecins et chercheurs impliqués dans les LGMD.
https://lgmd.afm-telethon.fr/blog/
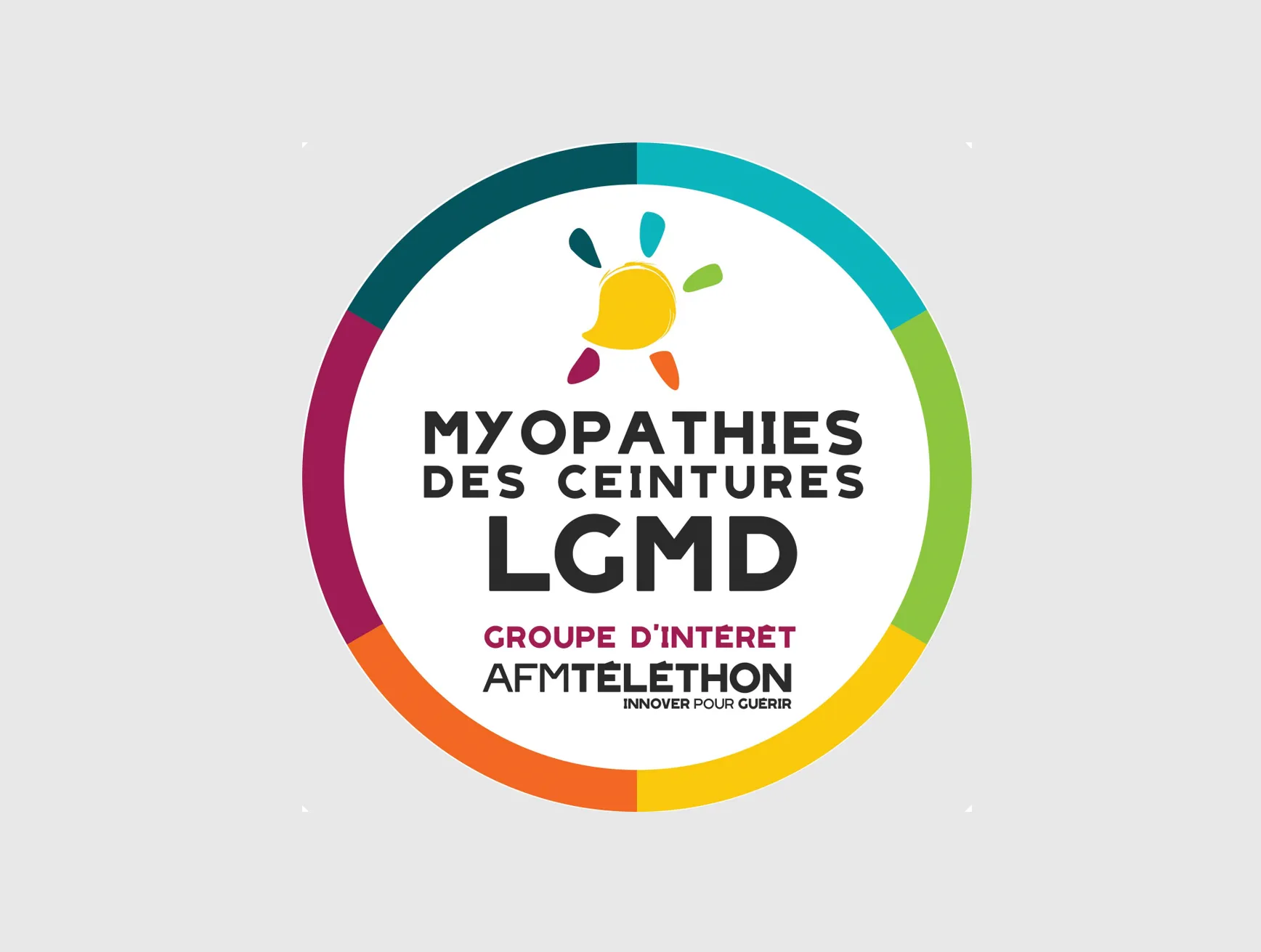

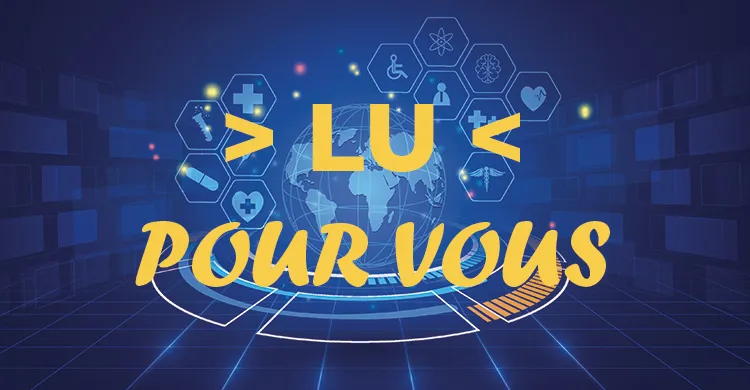


Comment évolue-t-elle ?
L’évolution de la LGMD R1 est variable, mais reste globalement assez lente.
Les muscles des membres inférieurs peuvent s’affaiblir avec le temps. Paradoxalement, les mollets ont parfois l’air très musclés sans être pour autant être particulièrement forts (on parle de « pseudo-hypertrophie »), et les tendons d’Achille ont tendance à se raccourcir (on parle de « rétraction »). Tout cela entraine des difficultés de mobilité, notamment pour courir, se relever d’une chaise...
La perte de la marche peut survenir entre 10 et 30 ans (variable) après l’apparition des premiers signes, en particulier si les muscles fessiers deviennent atteints. À cause de l’atteinte des muscles des épaules, lever les bras devient plus difficile et, dans les formes les plus évoluées de la maladie, certains gestes du quotidien peuvent être impactés, comme se coiffer, attraper des objets en hauteur, s’alimenter, ou encore utiliser un ordinateur.
Assez fréquemment, la transformation du tissu musculaire peut entrainer un enraidissement et un raccourcissement des muscles qui est responsable, notamment en l’absence de prise en charge orthopédique, de déformations articulaires.
Une atteinte respiratoire est assez commune dans cette maladie, mais peut s’observer assez tard dans son évolution. Une atteinte cardiaque reste rare dans cette forme de LGMD.