Myopathie des ceintures de type R2 (dysferlinopathie)
La myopathie des ceintures avec déficit en dysferline (LGMD R2) est une maladie rare qui touche le muscle. Elle se manifeste par une diminution progressive de la force des muscles du bassin et des cuisses (ceinture pelvienne) et des épaules (ceinture scapulaire).
La myopathie des ceintures de type R2 : qu’est-ce que c’est ?
La myopathie des ceintures avec déficit en dysferline (LGMD R2 liée à la dysferline ou dysferlinopathie, anciennement myopathie des ceintures 2B ou LGMD 2B) est une maladie génétique rare du muscle. Le tissu musculaire se transforme petit à petit, et perd de son intégrité structurelle : il devient « dystrophique » (d’où le nom de dystrophie musculaire des ceintures). Progressivement, certains muscles perdent du volume, s’affaiblissent, leur capacité de régénération diminue…
Elle débute habituellement à l’adolescence ou chez l’adulte jeune par une diminution progressive de la force des muscles des cuisses et du bassin (ceinture pelvienne) et des muscles des épaules (ceinture scapulaire). La faiblesse des muscles des jambes entraîne des difficultés pour courir, monter les escaliers, se relever du sol... L’atteinte musculaire des membres inférieurs peut aussi être « distale », les mollets notamment peuvent être touchés. Aux membres supérieurs, en dehors des épaules, les biceps sont les muscles principalement touchés.
La LGMD R2 est particulièrement fréquente dans certaines populations fortement consanguines, notamment au Maghreb, au Moyen-Orient et en Inde. Elle peut représenter jusqu’à 15 % de l’ensemble des cas de LGMD.
La myopathie distale de Miyoshi est aussi liée au gène DYSF impliqué dans la LGMD R2. Ces deux formes de myopathie peuvent coexister au sein de la même famille, certaines personnes présentant une LGMD R2 et d’autres une myopathie distale de type Miyoshi.
À quoi est-elle due ?
La LGMD R2 est due à des anomalies dans le gène DYSF, codant la dysferline (d’où le nom de dysferlinopathie), une protéine localisée dans la membrane de la fibre musculaire. Elle est impliquée dans le bon fonctionnement des cellules musculaires, et notamment dans des processus de réparation de leur membrane. La LGMD R2 est une maladie héréditaire qui se transmet de manière autosomique récessive. Dans certains cas, elle peut être due à des mutations dites « de novo », qui n’étaient présentes chez aucun des deux parents.
Que peut-on faire ?
La prise en charge vise principalement à améliorer le confort de vie des malades et à prévenir les complications, en particulier au niveau des muscles et des articulations.
- Le diagnostic et la prise en charge d’une LGMD R2 se conçoivent au mieux dans le cadre de consultations pluridisciplinaires spécialisées dans les maladies neuromusculaires.
- Une surveillance annuelle est recommandée pour faire un bilan musculaire, orthopédique, cardiaque et respiratoire.
- La prise en charge orthopédique (kinésithérapie, appareillage) doit être précoce, régulière et adaptée à chaque situation individuelle. Elle permet de lutter contre l’enraidissement musculaire et les rétractions, et d’entretenir la souplesse des articulations.
- Des aides techniques (canne, pince à long manche, support de bras…) peuvent permettre de réaliser certains gestes de la vie quotidienne que la gêne musculaire rend difficiles ou impossibles. L’utilisation d’un fauteuil roulant permet de conserver son autonomie de déplacement.
- Un suivi cardiologique régulier permet de mettre en place un traitement adapté au cas où des signes cardiaques éventuels seraient détectés par les examens médicaux.
- Une assistance respiratoire est très exceptionnellement nécessaire.
- Le conseil génétique permet d’informer et d’accompagner une personne, ou une famille, sur le risque de développer ou de transmettre cette maladie.
Comment fait-on le diagnostic ?
Le diagnostic est basé sur l’identification des muscles atteints, l’âge d’apparition des premiers symptômes, l’évolutivité et le mode de transmission génétique de la maladie. Il s’appuie également sur des examens médicaux (prise de sang, scanner ou IRM musculaires, électromyogramme, biopsie musculaire) pour préciser l’étendue de l’atteinte musculaire et ses spécificités et identifier la mutation génétique en cause.
- Le bilan biologique sanguin montre une élévation importante (jusqu’à 50 fois la normale) de l’enzyme musculaire créatine phospho-kinase (CPK).
- L’électromyogramme révèle une absence de lésions nerveuses et une origine musculaire (myopathique) de la maladie.
- L’analyse par microscopie des échantillons musculaires prélevés par biopsie montre des particularités de la structure tissulaire caractéristiques d’une « dystrophie » du muscle. Notamment avec des zones contenant des fibres de différentes tailles, indicatrices d’un phénomène de dégénérescence-régénération répété. Le diagnostic repose également sur une absence complète ou une réduction très importante de la dysferline au niveau de la membrane musculaire sur le fragment musculaire étudié.
- L’analyse génétique mettant en évidence une mutation pathologique dans le gène DYSF est indispensable pour poser avec certitude le diagnostic de dysferlinopathie.
À la recherche de traitements
Différentes stratégies thérapeutiques sont à l’étude dans les myopathies des ceintures ; elles ciblent et agissent à différents niveaux (ADN, protéine, métabolisme…) de la chaine d’évènements menant à la maladie.
- La thérapie génique consiste à insérer dans les cellules de la personne malade un « gène-médicament » qui compensera le gène muté originel et assurera sa fonction. Les essais cliniques de thérapie génique dans les myopathies des ceintures se multiplient, et des résultats préliminaires encourageants (LGMD R4, R9…) ont déjà été obtenus dans plusieurs d’entre eux.
Pour en savoir plus :
la thérapie génique dans les myopathies des ceintures (site du Groupe d’intérêt LGMD de l’AFM-Téléthon
- La thérapie cellulaire vise à administrer à la personne malade des cellules souches d’un donneur sain (allogreffe) ou du soi (autogreffe) après les avoir corrigées par édition génique (notamment grâce à l’outil CRISPR/Cas9), pour restaurer les capacités réparatrices du muscle.
- La thérapie pharmacologique utilise des petites molécules de natures différentes (sucres, protéines, acides aminés…) pour corriger des processus biologiques (glycosylation, autophagie…) perturbés chez le malade. Plusieurs candidats-médicaments sont à l’essai dans les LGMD, comme le ribitol ou le bazédoxifène.
Depuis 2015, le laboratoire I-stem travaille sur des cellules modèles de myopathies des ceintures pour identifier des candidats-médicaments parmi des molécules déjà connues.
Le groupe d’intérêt AFM-Téléthon LGMD
Il rassemble des malades atteints de LGMD, experts de cette maladie. En plus du partage d’expériences, il apporte une information médicale et scientifique régulière sur son blog ou lors de journées d’information, en lien avec des médecins et chercheurs impliqués dans les LGMD.
https://lgmd.afm-telethon.fr/blog/
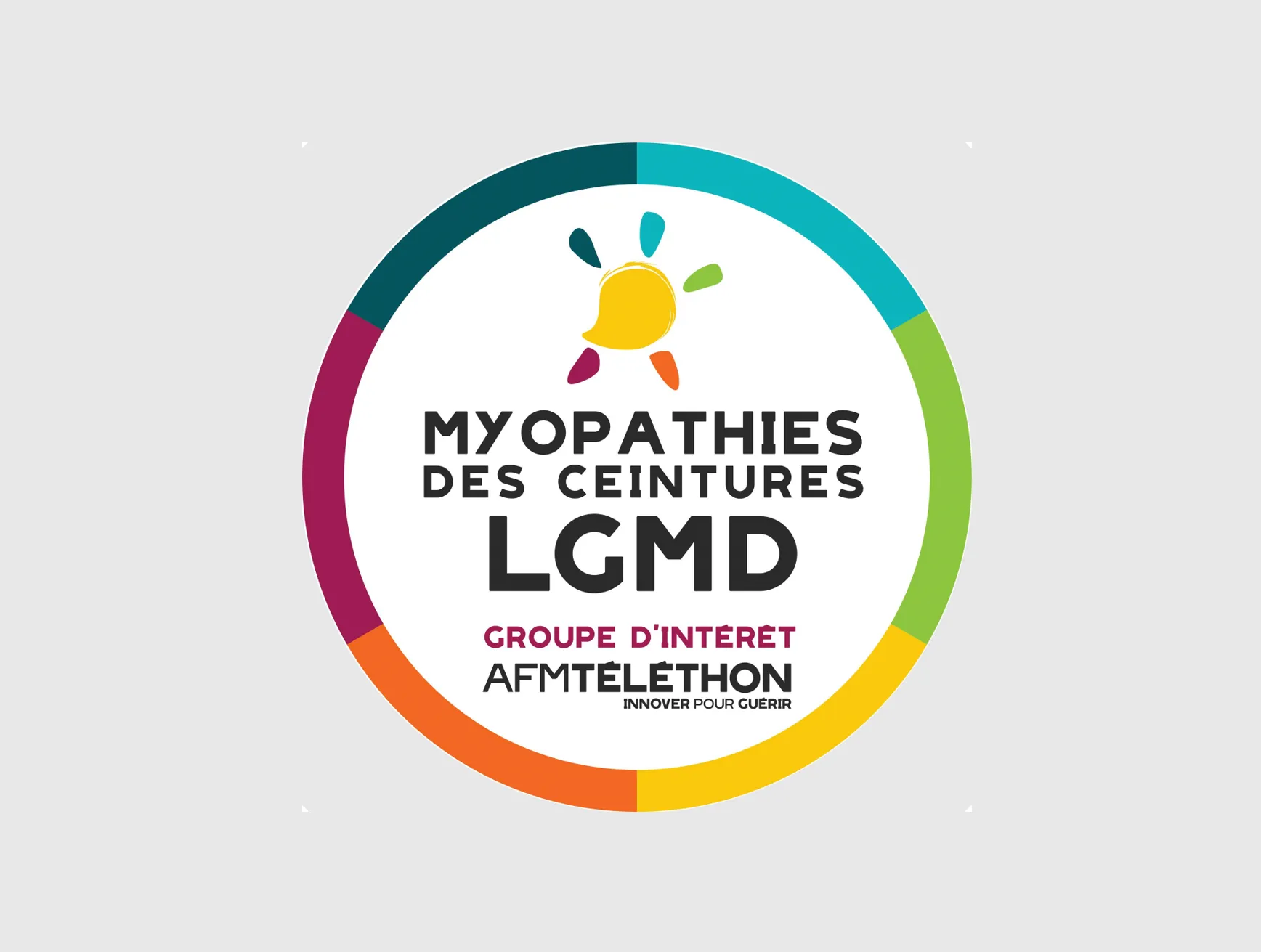


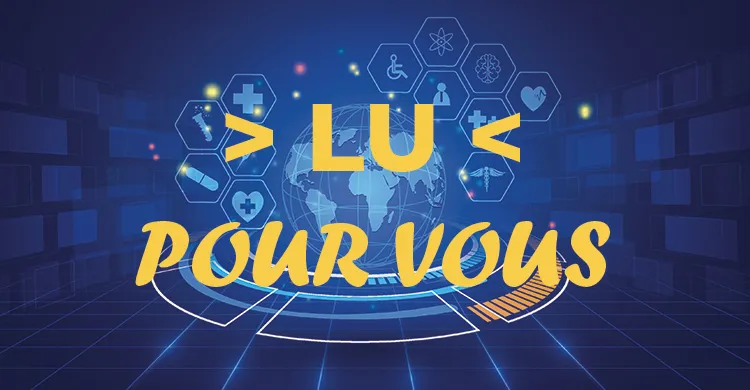

Comment évolue-t-elle ?
La LGMD R2 évolue de façon très variable, mais globalement lente, avec une progression descendante de l’atteinte musculaire, vers les muscles des mollets notamment.
Les muscles des épaules sont relativement épargnés, avec très peu ou pas de décollement des omoplates. En revanche, au niveau des jambes, l’atteinte musculaire peut s’étendre à des muscles plus distaux.
La perte de la force musculaire s’accompagne d’un enraidissement des muscles et des articulations et peut entraîner, notamment en l’absence de prise en charge orthopédique, des déformations articulaires.
Une atteinte du muscle cardiaque (cardiomyopathie) et une atteinte respiratoire modérée sont possibles.
La perte de la marche éventuelle (chez 10 à 15 % des malades environ) se fait au bout d’une quinzaine d’années d’évolution en moyenne, même si dans de rares cas, il ne s’écoule que quelques années entre le début des symptômes et le recours à un fauteuil roulant.
À l’inverse, certaines personnes porteuses d’une mutation pathogénique du gène DYSF ne voient apparaître les premiers symptômes que très tardivement (après l’âge de 60 ou 70 ans), voire pas du tout.